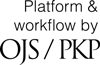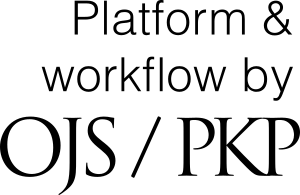Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
> Tous les numéros
Dossier : Règles, régularités et création
|
Maîtres des règles. Guido Ferraro
Publié en ligne le 26 décembre 2022
|
|
|
En vérité, on ne sait pas même très bien de quoi il s’agit, en sémiotique, quand on parle de règles et de régularités, car il y a tout un ensemble de concepts apparentés : on parle de conventions, d’unités codifiées, de schémas, de modèles, de pratiques sociales consolidées... Même l’opposition système / procès ne nous aide pas à comprendre mieux : comme on le verra ci-dessous, un ensemble de règles, parce qu’il présente un caractère systématique, n’est pas pour cela exclu des caractères qui sont propres aux procès sociaux. Les choses ne semblent pas plus claires si on considère le rapport entre règles et créativité : on peut penser qu’il existe des règles de la créativité, ou vice versa qu’on crée contre les règles, simplement en les transgressant, ou bien en appliquant des règles différentes de celles qui sont habituelles, ou encore que l’agir créatif est lui-même une activité qui produit des règles, ses propres règles1. |
1 On peut rappeler à cet égard l’idée d’Umberto Eco, qui voyait l’invention comme une « institution de code », Trattato di semiotica generale, Milan, Bompiani, 1975, p. 315. |
|
Je vais essayer de faire face à cet enchevêtrement conceptuel en partant d’une attitude anthropologique, c’est-à-dire à partir de l’idée que tout système de règles est, en tant que tel, le résultat d’un processus créatif : il s’agit toujours de produits de l’intellect humain, foncièrement conçus pour permettre et soutenir nos possibilités d’expression. J’envisagerai donc un système de règles non pas comme un ensemble de limitations et d’interdictions, mais comme, en premier lieu, un ensemble de ressources. Dans mon effort de tracer un parcours si possible clarifiant, je vais aussi m’appuyer sur les créateurs eux-mêmes — les auteurs de littérature, cinéma, musique, œuvres visuelles... — pour ce qu’on peut tirer, plus que de leurs discours théoriques, de ce qui est implicitement argumenté dans leurs œuvres et illustré dans leurs processus créatifs. Je crois aussi utile de rappeler que l’idée de la présente exploration collective du rapport entre règles et créativité est née des réflexions que nous avons menées ensemble dans un précédent forum sur le rythme, dont est issu le numéro précédent de cette revue. Il est beau en effet qu’il y ait des fils de discours qui se poursuivent à travers des étapes successives, en abordant des thèmes qui ne sont au fond que partiellement différents. Le rythme nous était apparu comme une étrange entité qui se présente à la fois comme modèle élémentaire d’une règle extérieure, comme un principe d’organisation auquel il faut se conformer, et comme un instrument de variation créative individuelle. D’une certaine manière, nous reprenons donc ce discours où nous l’avons laissé. |
|
|
« Codes », « langues », et formes d’action sociale Je vais donc partir (ce qui me semble inévitable) de la sémiotique des années 1970. On utilisait alors des termes ensuite tombés, dans une certaine mesure, en désuétude, comme c’est le cas surtout pour la notion de « code ». Il est vrai que notamment dans la vision sémiotique d’Umberto Eco, cette notion est restée toujours centrale2, mais cela fait partie d’une orientation secondaire, qui mène la réflexion sémiotique vers une direction toujours plus philosophique. À d’autres égards, ce terme fait penser à la version vulgate de ce médiocre modèle de la communication qu’on a injustement attribué au pauvre Roman Jakobson, modèle qui nous ramène à la vision mécaniste et disqualifiée de la cybernétique. Dans leur Dictionnaire, Greimas et Courtés soulignent la variété et l’ambiguïté des utilisations de ce terme, ainsi que les usages naïfs liés à la reprise des concepts de la théorie de l’information3. Cependant, ils font également référence à une utilisation plus mature, de sorte que le concept inclurait la morphologie et la syntaxe, donc les deux composantes qui sous-tendent la production textuelle. En ce sens, ils soulignent aussi la dérivation du concept saussurien de « langue ». |
2 Voir en particulier son Trattato di semiotica generale, op. cit. 3 Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. |
|
Il y avait en effet quelque chose de beaucoup moins banal, qui sur la poussée de cette vague semblait destiné à disparaître de l’horizon, à savoir la vision des règles comme fait social que Ferdinand de Saussure avait condensée dans le concept de langue. Comme dans d’autres cas, la vision de Saussure était marquée par un excès de simplification ; déjà Hjelmslev avait proposé d’articuler le concept saussurien dans au moins trois composantes différentes, dites schéma, norme et usage4. Mais ce qui nous rend plus difficile de faire référence à Saussure, c’est le fait que sa théorie se limitait à considérer des systèmes de corrélation signifiant /signifié sur base arbitraire, alors que les systèmes dont nous nous occupons surtout (de la littérature au cinéma, de l’expression musicale aux arts visuels, etc.) ont tendance à employer des corrélations de nature analogique. |
4 L. Hjelmslev, Essais linguistiques, Paris, Minuit, 1971, chapitre « Langue et parole ». |
|
Il faut en tout cas remarquer que Saussure, à propos de la notion de langue, oscille entre deux conceptions très différentes. La première est de caractère, dirions-nous, normatif au sens libéral, car la langue se propose comme un ensemble de règles placées au-dessus des individus, mais neutres par rapport à leur faire sémiotique : de sorte que chacun, grâce à ces règles, peut exprimer librement sa pensée. L’autre conception, très différente, voit en revanche dans l’institution sociale de la langue une force capable de façonner l’organisation de la pensée et de conditionner les productions expressives possibles par les membres du groupe. Cette perspective, avec tous les appuis qui pourraient être trouvés dans la pensée de Heidegger et de Lacan, et peut-être de Wittgenstein et de Humboldt, se répandit fortement dans les années 1970, amenant beaucoup de monde à répéter le mantra selon lequel nous serions « parlés par notre langue ». On voit encore ici une simplification, mais significative, car elle nous conduit à penser que chaque ensemble de règles, précisément parce qu’il permet, promeut et facilite certaines modalités d’expression, par cela même en défavorise d’autres, les rendant du moins improbables. Cette perspective est intrigante dans le domaine du langage, mais beaucoup plus évidente et indispensable quand on la transpose dans d’autres domaines sémiotiques. Bien que, à propos de ces concepts, on puisse mener des discussions philosophiques sans fin, tout le monde s’accorde à dire que, par exemple en peinture, la « grammaire impressionniste », ou « cubiste », ne constitue pas du tout un système de règles neutres, mais correspond déjà en elle-même au choix d’une perspective, à une manière déterminée de parler du monde. |
|
|
Les considérations de Saussure ne se limitaient pas au niveau lexical : il remarquait par exemple comment les règles de la flexion verbale correspondent, dans différentes langues, à différentes manières de conceptualiser l’expérience du temps5. Et c’est précisément sur la conceptualisation du temps qu’a ensuite beaucoup travaillé Benjamin Lee Whorf, notamment grâce à ses études sur la langue hopi6. Ce n’est pas ici le lieu de discuter de la justesse de ses études ; sa thèse centrale est que les catégories de la langue guident de manière décisive la façon dont nous percevons et structurons mentalement les faits d’expérience. Cette perspective change profondément l’idée du rôle qu’il convient d’attribuer aux règles, et peut-être encore plus l’idée du rapport entre règles et créativité — étant donné que nous pensons qu’une tâche des esprits créatifs est justement de changer notre vision du monde. |
5 Cf. Cours de linguistique générale (1916), Paris, Payot, nouvelle éd., 1967, pp. 161-162. 6 Language, Thought, and Reality, Cambridge, M.I.T. Press, 1956. |
|
En 2016, une équipe de cinéastes (Ted Chiang, Eric Heisserer, Denis Villeneuve et d’autres) a produit un film d’imagination intitulé Arrival, explicitement fondé sur l’hypothèse Sapir-Whorf : il raconte l’arrivée d’extraterrestres dont les hommes ne peuvent pas comprendre le langage (en l’occurrence plus graphique que verbal). La protagoniste, professeur de linguistique, déchiffre enfin une partie de ce langage, qu’elle découvre fondé sur une manière profondément différente de conceptualiser l’expérience, notamment du point de vue de l’organisation du temps. Ce faisant, la chercheuse se trouve elle-même impliquée dans ce système d’expression « alien », ce qui permettra non seulement d’arriver à la solution du problème posé par l’histoire, mais aussi d’amener les êtres humains à modifier profondément leurs modes de relations réciproques. Ce qui nous intéresse, c’est de voir comment cette histoire imaginaire est profondément centrée sur l’étude des règles d’une grammaire, et sur la reconnaissance de l’influence qu’elles ont sur la perception des faits de notre vie. Cela est même rendu tout à fait palpable pour le spectateur par un récit bizarrement non linéaire, comme si la grammaire du film était contaminée par les traits de cette sémiotique toute autre ; le spectateur doit finalement accepter que cette histoire ne puisse être comprise que comme ayant une structure circulaire, étrangère au principe selon lequel ce qui précède est la cause de ce qui suit. On fait ainsi l’expérience, bien qu’imaginaire, de voir les choses à travers les règles propres à une grammaire qui n’est pas la nôtre. Le point est, pour nous, que le cinéma peut montrer une façon différente de voir le monde : une façon terrestre, certes, mais en même temps réellement étrangère. Et de fait, c’est une question de grammaire. Ce film nous intéresserait moins s’il s’agissait d’une invention atypique. Mais il s’inscrit dans un flux plus large de textes narratifs remontant aux dernières décennies du XXe siècle et qui culminent dans ce qui est considéré comme l’une des pierres angulaires de l’imaginaire contemporain, à savoir la trilogie cinématographique de Matrix. Au début de cette histoire compliquée, les hommes sont présentés comme prisonniers de machines informatiques qui programment un monde artificiel, construit par leur langage. Puis, en suivant l’évolution de l’histoire, on comprend que cette fiction narrative ne fait que projeter sur les machines des aspects de la société humaine qu’il nous est difficile de penser et d’accepter directement : ce sont nous, les hommes, qui utilisons le langage pour établir des configurations du monde et élaborer une image de la réalité collectivement partagée. Comment ne pas rappeler ici cette observation d’Emile Durkheim : « sans doute, en un sens, notre représentation du monde extérieur n’est, elle aussi, qu’un tissu d’hallucinations »7 ? |
7 Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Paris, P.U.F. 1960, p. 325. Pour une réflexion sur la théorie sémiotique de Durkheim, cf. G. Ferraro, « Antenato totemico e anello di congiunzione. La connessione tra “sacro” e “segno” nel pensiero di Émile Durkheim », in N. Dusi et G. Marrone (éds.), Destini del sacro, Rome, Meltemi, 2008. |
|
Est donc en train de s’affirmer, dans la culture diffuse, le principe selon lequel les règles ne s’imposent pas de l’extérieur mais, bien que nous puissions en être peu conscients, viennent de nous, et tendent à définir la représentation de la réalité que la culture dont nous faisons partie décide de projeter sur les objets du monde. On voit les règles comme la forme de notre pensée, et en même temps, et par conséquent, comme ce qui établit la forme du monde. J’ai cité à ce sujet un grand auteur injustement ignoré dans les histoires de la sémiotique, car cette perspective correspond à cette forme de kantisme sociologique proposée par Durkheim : pour lui, les catégories et les règles qui régissent la langue ainsi que les systèmes symboliques ne sont pas « expression » ou « représentation » d’entités extrasémiotiques (le groupe, la société...) car de son point de vue ces entités constitutives du social sont immédiatement des réalités de nature sémiotique : ces règles, et les systèmes de représentations collectives qu’elles établissent, sont directement des formes d’action sociale, concept que nous devrions considérer très attentivement. Et en fait nous pouvons déjà donner à partir de là une réponse à une question que nous avions posée : les systèmes de règles, faisant partie intégrante de l’agir social, se présentent comme des procès dynamiques, et c’est en tant que tels qu’ils devraient être étudiés. |
|
|
Sur le statut des règles de la grammaire narrative Une des raisons pour lesquelles l’intérêt pour les codes et les systèmes de règles a nettement diminué dans la sémiotique des années 1970 a sans doute été le déplacement de l’attention du niveau du système vers celui du texte. Ce qui est compréhensible, mais en même temps naïf, car les deux niveaux sont évidemment en rapport de présupposition réciproque : l’étude du système se fait par l’analyse des textes, et l’analyse des textes suppose la référence à des catégories et des modèles plus généraux (comme c’est le cas des modèles actantiels, des schémas canoniques, etc.) dont, comme je vais maintenant essayer de le montrer, le statut d’unités codifiées risque d’être négligé. Considérons les règles de la syntaxe narrative. Vladimir Propp a montré comment les contes de fées russes, qui semblent l’expression d’une fantaisie enchantée et débridée, obéissent tous à un modèle de construction rigide et fixe8. On peut omettre certains éléments constitutifs, mais on ne peut pas les modifier, en intervertir la place, les remplacer par d’autres : la logique qui régit ce schéma de composition doit être maintenue inchangée. Nous pouvons certes constater que Propp, dans une certaine mesure, a forcé cette rigidité, ou que dans son corpus de contes il faudrait distinguer au moins deux schémas de composition sensiblement différents, mais cela ne touche pas l’idée centrale, qui a donné à Greimas la possibilité de parler d’un schéma narratif « canonique » : un schéma essentiel, qui résume plusieurs des règles de base pour la construction des textes narratifs. |
8 Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1965. |
|
Or, le schéma de composition de Propp n’est ni universel ni idéologiquement neutre : il transmet aux jeunes générations un modèle pour conceptualiser l’histoire personnelle en termes d’une suite de moments de croissance, accomplis grâce à une série d’épreuves régies par un contrat. Ce contrat intervient pour relier deux Manques, l’un du Sujet et l’autre du Destinateur, et ainsi permettre de faire correspondre entre elles des entités disparates, placées les unes sur le plan des valeurs objectives (résultats d’un faire matériel), les autres sur le plan des valeurs subjectives, en soumettant ainsi la définition identitaire du Sujet à cette grille de valeurs institutionnelle dont le Destinateur se porte garant. Cela conduit en fin de compte à la fusion entre le plan contrôlé par une instance normative et le plan subjectif et opérationnel où agit le protagoniste : une fusion particulièrement bien représentée par le mécanisme narratif de la séquence des Noces9. Tout cela représente une manière spécifique, l’une des différentes manières possibles, de conceptualiser le rapport entre individu et groupe, entre action et identité, entre le désir et l’assujettissement, entre la force des aspirations et celle de l’autorité. Et cette idée d’une fusion harmonique entre les programmes narratifs des individus et ceux des institutions serait tout à fait inconcevable sous d’autres perspectives. Ce schéma narratif constitue donc une entité codifiée, dans le sens où il convient de parler de codes culturels, de manière à éviter de considérer ces structures syntaxiques comme universelles, existantes hors de l’histoire et des pratiques sociales de production de sens. Les règles de la narration cèdent décidément leur apparence d’appareil purement formel, pour révéler leur nature idéologique : « idéologique » au sens propre, car ceux qui vivent dans ce genre de culture intériorisent ce modèle, si bien qu’ils le perçoivent comme une donnée d’expérience, objectivement constatable dans les faits de la « vie réelle ». Les règles de cette grammaire constituent vraiment le socle d’une action sociale, et c’est précisément pour cela que tout le monde ne peut pas en partager les valeurs sous-jacentes ; un auteur de culture romantique, par exemple, ne le ferait jamais : il refuserait explicitement de jouer à l’intérieur de ces règles, et ferait tout pour en proposer d’autres. |
9 Pour cette relecture de la logique constitutive du schéma de Propp, voir G. Ferraro, Teorie della narrazione, Rome, Carocci, 2015. |
|
Créativité : voir le monde sous une autre lumière Il faut donc penser les règles non seulement comme le produit de notre volonté partagée, mais aussi comme un ensemble de normes que nous trouvons déjà constituées et dont nous devons prendre nos distances si voulons être créatifs. Voyons ce qu’explique à ce sujet un cinéaste au talent créatif, M. Night Shyamalan, conteur génial qui par la suite a malheureusement pris des chemins beaucoup moins intéressants. Le film de 1999 qui l’a fait connaître, The Sixth Sense, s’ouvre sur l’image insistante d’une lampe à incandescence qui s’allume progressivement, de l’obscurité totale à la pleine lumière10. Lors d’une première vision du film, personne n’y prête attention, mais il se peut qu’à une deuxième vision le spectateur y reconnaisse une allégorie très facile à lire : le passage progressif de l’obscurité à la lumière renvoie évidemment au passage d’une incapacité à comprendre à une connaissance acquise. De fait, ce film raconte précisément l’histoire d’un psychologue qui, seulement à la fin, après beaucoup de difficultés, arrive à trouver quel est le problème qui angoisse son jeune patient. Il est donc facile de comprendre que cette image présentée en ouverture annonce le sujet même du film : on va nous expliquer comment on passe de l’incompréhension à la connaissance. |
10 Pour une analyse plus détaillée voir G. Ferraro, Fondamenti di teoria sociosemiotica, Rome, Aracne, 2012, pp. 117-124. |
|
Très simple, dirait-on... mais on va voir que ce n’est pas le cas. La facilité d’interprétation de cette image découle évidemment du fait qu’il s’agit d’une occurrence (token) de quelque chose de plus général que nous connaissons déjà (type). Une petite lampe qui s’allume est en plusieurs langues, et dans le langage graphique universel des bandes dessinées, une métaphore répandue pour dire « J’ai eu une idée », ou « J’ai enfin compris ». Il y a bien sûr une règle là derrière : tout cela repose sur un modèle conventionnel. Si on comprend cette image, c’est parce qu’elle fait déjà partie de notre bagage sémiotique. Faut-il en déduire qu’on ne peut comprendre que ce qu’on connaît déjà ? En fait, le développement de ce récit tend à montrer précisément l’inverse : nous ne devons pas présumer qu’on puisse comprendre le réel en y superposant des modèles déjà connus. Telle est l’erreur du protagoniste, psychologue incapable d’une véritable écoute, qui ramène ce que son patient lui raconte aux modèles qu’il a appris dans les livres, superposant ainsi au cas nouveau les catégories (donc les règles interprétatives) préétablies de son savoir. Mais comment pouvons-nous atteindre des connaissances qui ne soient pas prédéterminées par notre savoir acquis ? Il est vrai que l’écran noir qui, au début, s’illumine progressivement, peut aussi bien renvoyer à la projection cinématographique elle-même, et ainsi devenir (grâce aussi à des confirmations ultérieures) une métaphore du cinéma : qu’est-ce en effet que le cinéma sinon le lieu de la surprise, et de la possibilité de voir le monde, pendant un certain temps, à travers les yeux d’un autre ? Plus précisément, comment ce film, en dessinant une configuration métaphorique nouvelle et créative, montre-t-il la manière dont son protagoniste parvient à comprendre ce qui lui était d’abord obscur ? Voilà le premier épisode décisif : le psychologue réécoute pour la énième fois la bande audio sur laquelle sont enregistrés ses entretiens avec un patient précédent, mais cette fois il ne saute pas la partie qui serait par définition insignifiante, la partie vide car correspondant à son absence momentanée. C’est précisément là qu’il trouve les indices qui le conduiront à la solution. Il y a ensuite toute une série d’épisodes similaires, où l’on comprend une vérité en regardant dans des espaces qui devraient être vides, dans des lieux insignifiants, en donnant un sens à des paroles et des gestes qui sembleraient sans importance. Cette série d’épisodes différents mais que nous sentons unis par une certaine équivalence de sens, conduit le spectateur à saisir la présence d’une nouvelle structure sémiotique créée dans le texte, et dont nous comprenons la valeur : il y a donc une autre façon de connaître. Ce qui peut, entre autres, nous amener à réinterpréter encore l’image de départ, maintenant en rendant pertinent le fait que la lumière qui s’allume au début du film s’enfonce dans une cave, c’est-à-dire dans un lieu par définition réservé à l’obscurité : là où la lumière est donc une présence inattendue, divergente et anormale. |
|
|
Ce film prend ainsi position du côté de ceux qui pensent que la tâche des créateurs est de nous conduire au-delà des manières habituelles de voir les choses, en nous surprenant par d’autres perspectives et d’autres dispositifs sémiotiques. Cependant, ce film et son mécanisme créatif n’impliquent la violation d’aucune règle ; au contraire, nous y voyons mise en œuvre une règle bien connue en grammaire narrative11, celle selon laquelle la partie finale d’un texte narratif expose le « contenu posé », c’est-à-dire ce que le texte veut affirmer, son noyau sémantique et conceptuel, tandis que les segments initiaux proposent un « contenu inversé » : ils expriment le contraire de ce qu’en fin de compte le texte affirmera. On a trop peu réfléchi à la façon dont ce principe ouvre une perspective d’intérêt décisif sur la dimension syntaxique du récit et sur les règles génératives qui gouvernent la construction du texte. Tout d’abord, nous voyons ici dépassée la simple représentation linéaire de la syntagmatique textuelle, que nous découvrons dissimuler un dispositif basé sur des relations d’opposition paradigmatique. À bien y regarder, nous sommes face à une forme de dynamisation du principe saussurien du sens par différence (la différence valorisante est projetée sur l’écart entre le début et la fin du récit). Nous découvrons ici la possibilité de développer un espace laissé dans l’ombre par le modèle génératif de Greimas : l’espace où nous voyons comment les séquences qui composent la structure sémio-narrative (niveau « superficiel ») vont s’établir par un processus progressif d’expansions et de renversements. |
11 Cf. G. Ferraro, « Du début à la fin. Aventures du sens et de l’écriture dans les textes narratifs », Actes Sémiotiques, 123, 2020. |
|
A cet aspect syntaxique peut être aussi liée la distinction entre topic et focus, aujourd’hui redevenue d’actualité, où on entend par focus ce que le texte soutient comme affirmation propre, savoir nouveau et original, et par topic le thème qu’il pose au début, la question d’où il part, mais aussi ce qui est déjà connu, savoir partagé mais dépassé, dont le texte entend prendre ses distances12. De cette façon, on constate que le mécanisme d’opposition entre le début et la fin d’un récit (du contenu inversé au contenu posé) constitue déjà en soi un dispositif qui présente, dans la séquence narrative, la manière dont peut intervenir un processus d’innovation : nous pouvons considérer la structure grammaticalisée du récit comme un mécanisme permettant d’aller de l’ancien au nouveau, du passé au futur, de l’actuel au possible, du réel à l’imaginaire. |
12 Pour une discussion sur la valeur actuelle de la relation topic / focus, cf. G. Ferraro, Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2019, chap.II. |
|
Ces principes s’appliquent très bien au cas du film dont nous parlons : la lumière qui s’allume au début pose évidemment une question, annonçant le thème que le texte va aborder (topic). Mais cette image stéréotypée se renverse ensuite dans l’idée clé qui correspond au focus du texte, et qui conduit à la résolution conclusive. Si on y réfléchit, allumer cette ampoule électrique est un processus guidé par un agent sujet : elle s’allume à la suite d’un geste délibéré, elle est un outil au service de notre regard : nous voyons là où nous dirigeons le faisceau de lumière. L’inversion concerne donc la définition du lieu du savoir : celui-ci est en définitive placé non pas au centre, sous le faisceau de lumière, mais plutôt au-delà de sa limite et de son espace évident, au-delà du lieu où notre regard est habituellement guidé. Cette dynamique est aussi proche de ce que Lévi-Strauss disait à propos de l’espace de l’imaginaire, espace qu’ il distinguait (à l’intérieur de l’univers narratif) de l’espace du réel et de celui du symbolique13. Bien qu’à première vue le domaine de l’imaginaire paraisse relever d’une fantaisie sans règles, Lévi-Strauss le reconnaît comme résultat de l’application de règles formelles de transformation bien précises, liées notamment à des mécanismes de négation et de renversement. Des règles, donc, qui agissent comme des matrices de créativité. Ce genre de processus dynamique permet d’élargir sans limites le terrain de notre imaginaire, d’établir de nouvelles directions expressives, de créer des figures et des récits radicalement inédits — cela grâce, justement, à l’action d’un système de règles. |
13 Voir G. Ferraro, Il linguaggio del mito, Rome, Meltemi, 2001, pp. 300-305. |
|
De plus, dans la vision d’un chercheur en sciences sociales comme Lévi-Strauss, ces mécanismes ne doivent pas être conçus en termes de simples processus formels : il s’agit de pratiques sociales qui servent à exprimer des divergences de pensée, des positions culturelles distinctes. Ces transformations sont sémantiquement et pragmatiquement orientées, inscrites dans le cadre de confrontations dialogiques et polémiques. Exactement comme nous l’avons vu à propos de notre exemple : il ne s’agit pas simplement de se montrer « créatif » en produisant d’une façon ou d’une autre une inversion de contenu (par exemple le contraire d’une lampe qui s’allume) — mais plutôt de prendre position et de soutenir une manière de penser qui s’oppose à la manière courante pour aller dans une direction autre et bien définie. En d’autres termes, au lieu d’aller « contre les règles », il s’agit d’aller vers d’autres règles. |
|
|
Il n’est pas surprenant que les auteurs, en particulier ceux qui créent des récits littéraires, se montrent conscients de la manière dont leurs œuvres relèvent de formes et de modèles dont ils perçoivent les valeurs idéologiques et la détermination historique. Il en va de même dans d’autres domaines de la créativité, à tel point que nous savons qu’une œuvre picturale ou photographique vaut souvent en premier lieu en tant que réflexion sur les modes de la représentation visuelle, de même qu’une œuvre musicale semble « méta-réfléchir » sur l’essence même de la musique. Et ainsi de suite. Parmi les nombreuses références littéraires possibles, laissons de côté les plus évidentes et les plus récentes, Italo Calvino ou Alain Robbe-Grillet par exemple, eux-mêmes d’ailleurs influencés par les théories sémiotiques, et tenons-nous en à un classique reconnu comme d’un intérêt particulier, Jacques le fataliste et son maître. De son auteur, Denis Diderot, nous ne pouvons ignorer ni la position historique (à la veille de la Révolution) ni la qualité de principal créateur de cette Encyclopédie qui a tant contribué à changer la conception et le rôle du savoir. Considérons cependant ce livre pour ce qu’il est : une œuvre littéraire et non un texte proprement philosophique. Comme on sait, il présente deux personnages, le serviteur Jacques et son maître, qui, au cours d’un voyage vers une destination indéfinie, se racontent mutuellement leur vie (amoureuse, mais pas seulement). Les deux récits se poursuivent à grand peine, notamment celui de Jacques, à travers une série d’interruptions, diversions et digressions innombrables où s’insèrent d’autres récits, racontés par ces mêmes personnages ou par d’autres, dans un jeu de poupées russes, d’accidents et d’imprévus, ce qui fait de la lecture du roman une aventure accidentée et chaotique. De plus, pèsent lourdement les interventions fréquentes d’un narrateur qui, contre toute logique habituelle, passe de manière incongrue de l’être assis sur le plan de l’énonciation au bouger sur celui de l’énoncé, jusqu’à se disputer avec ses lecteurs ou à déclarer qu’il n’a aucun contrôle sur ses personnages. Comme tout le monde le note, le roman pose certes le problème de l’existence d’un destin, avec Jacques qui, fataliste tel qu’il se déclare, soutient que tout ce qui se passe est déjà écrit « là-haut », comme sur un grand rouleau qui se déroule petit à petit. On peut donc dire que le topic du livre est celui de la contingence des événements, mais une lecture plus pertinente et plus respectueuse du texte me semble permettre d’y voir surtout une réflexion sur le rapport entre contingence et forme narrative. Cela parce que, de mille façons, le livre, qui déclare plusieurs fois qu’il n’est pas un roman, amène à réfléchir sur les façons dont la narration est habituellement organisée, sur les motifs et le sens du narrer, et sur les règles qui y sont sous-jacentes. D’autre part, les références fréquentes à la façon dont le narrateur organise son récit et à la façon dont ses lecteurs vont le lire, ainsi que la référence au « grand rouleau » où tout est déjà écrit, orientent l’attention sur la nature de l’écriture littéraire en tant que telle. Tout cela, associé à une irrépressible passion de raconter, détermine une imbrication incontrôlable de récits de toutes sortes qui ne parviennent qu’à peine à trouver leur place dans les pages du livre, comme s’il s’agissait de prouver qu’il y a dans le monde plus d’histoires qu’on ne peut en raconter, et plus de conteurs qu’on ne peut en écouter. La construction, de type picaresque, des deux personnages qui affrontent leurs aventures dans un voyage sans but — et que l’auteur lui-même compare à Don Quichotte et Sancho Pança — non seulement mélange et confond les deux formes classiques de la construction diégétique et dramatique, mais inclut des récits des genres les plus divers, anciens et contemporains, du récit chevaleresque au théâtre comique, comme pour nous dire qu’il s’agit d’une réflexion à large spectre sur les mécanismes du récit en tant que tels. Il serait facile de dire qu’en transgressant de bien des manières les règles traditionnelles, Diderot entend nous rendre conscients de leur présence et de leur action. Mais Jacques le Fataliste n’est ni un anti-roman ni une sorte de jeu, et cela parce que les choix de l’auteur ne sont pas simplement extravagants ou subversifs, mais orientés dans un sens déterminé. Ce qui est touché par l’ironie et la critique, c’est un ensemble de principes cohérents entre eux et correspondant à une manière définie de penser, et de raconter, une manière que l’auteur évidemment juge désormais inappropriée. Si, en tant que spécialiste des techniques narratives, on cherche alors quelle est la cible principale des piques critiques de Diderot, il est facile de relever tout ce qui se relie à une conception générale de type aristotélicien — observation d’ailleurs trop facile puisque le roman avoue explicitement avoir« péché contre les règles d’Aristote, d’Horace, de Vida et de Le Bossu ». Mais quelles sont au juste ces « règles » contre lesquelles ce livre« pèche » si gravement ? Pour commencer, de toute évidence on n’expose pas ici une seule histoire, complète et séparée ; il y a au contraire un grand enchevêtrement de récits différents qui bifurquent ou se croisent de manière imprévisible, qui manquent parfois de conclusion, qui n’ont pas de continuité narrative, qui ne se laissent pas ramener à un point de vue unitaire où situer leur narrateur. De plus, n’est pas respecté le principe d’enchaînement logique des événements, ni l’orientation essentielle vers un point d’arrivée défini et univoque. Sachant que la section finale d’une histoire est la plus décisive, il paraît tout à fait aberrant que l’histoire qui occupe le plus d’espace, celle du protagoniste Jacques — qui commence à la page deux et traverse tout le livre — ne soit pas racontée jusqu’à la fin. En compensation, nous pouvons suppléer à ce manque grâce à trois « Mémoires » (qu’il y aurait pourtant « de bonnes raisons de tenir pour suspects »). Nous avons donc trois fins apocryphes, dont la dernière se termine par une scène triviale et conventionnelle de reconnaissance. Comme pour nous dire : vous voulez la banalité des récits qui s’achèvent à la manière traditionnelle ? Alors, voici le dénouement le plus banal qui soit. |
|
|
Mais bien sûr, les règles d’Aristote n’étaient pas de nature formelle. Il s’agissait, dans sa perspective, de reproduire le réel sous une forme modifiée, afin de le rendre intelligible, généralisable et signifiant, afin de pouvoir y reconnaître des valeurs et des principes éthiques. Hans Ulrich Gumbrecht souligne le lien (ici en négatif) entre ces propriétés : le fait que les histoires de Diderot soient caractérisées par une forte contingence les rend singulières, de sorte qu’il est impossible de les référer à des concepts abstraits et à des principes généraux, et en conclusion, elles sont essentiellement dénuées de sens14. Mais, d’un autre côté, nous comprenons que ce sont précisément ces principes de la narration aristotélicienne qui font, des formes traditionnelles de récit, une construction artificielle et par conséquent insignifiante, trop éloignée de la façon dont se déroule la vie réelle. De son côté, Diderot souligne à plusieurs reprises que son non-roman, avec son incohérent méli-mélo d’événements qui se greffent les uns sur les autres, s’avère en dernière analyse beaucoup plus proche du vrai. Il y aurait donc une « vérité » qui serait approchée par la manière dont la narration est planifiée, ce qui inclut également la rupture de la relation conventionnelle entre le narrateur et l’histoire racontée. À ce propos, Diderot met en doute la validité des deux solutions proposées par l’alternative traditionnelle : l’extranéité du sujet énonçant au plan du discours énoncé, ou bien son implication en tant qu’acteur participant : se profile ici un sujet énonçant bien plus moderne, placé sur la marge, avec un pied à l’intérieur et un à l’extérieur du discours énoncé. |
14 Cf. H.G. Gumbrecht, Prose of the World. Denis Diderot and the Periphery of Enlightenment, Stanford, University Press, 2021, pp. 69 et 76. |
|
Car ce que Diderot met en cause dans ce livre, c’est ce qui éloigne le vieux modèle du « roman » de la conception moderne, telle qu’elle sera bien plus tard décrite en particulier par Mikhaïl Bakhtine15 : une conception polyphonique, ouverte, fondée sur la multiplicité des fils et des niveaux du récit, sur la confrontation entre les voix et les clés de lecture, sur l’absence d’un centre et d’une perspective unitaire16. Ce que présente Diderot n’est pas une simple « transgression des règles » mais un éloignement précisément orienté, qui, s’écartant d’un ancien système de règles, va dans une direction qui mènera finalement à un autre système de règles — et cela dans le contexte d’un changement culturel décisif, dont l’auteur est de toute évidence un protagoniste. Dans une certaine mesure, peut-être inconsciemment, Diderot a perçu que ces règles de la narration étaient les règles d’un monde qu’il était en train de conduire au crépuscule. En ce sens, changer les règles de l’écriture narrative était donc une modalité définie d’action politique. |
15 Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1987. 16 A. Wall, « Bachtin, Diderot, and the simultaneity of meaning », Russian Literature, XXXII, 1992. L’auteur remarque (p. 4) que le texte de Diderot est plus qu’une version rudimentaire de ce que Bachtin appelle prose polyphonique. |
|
Les maîtres des règles et ces messieurs Le siècle des Lumières mettait en doute — nous en comprenons bien les raisons — une grammaire du récit qui projetait sur les événements un logos transcendant, en supposant un ordre de l’univers qui par définition nous sauverait du chaos. Mais quand s’annonce une grande révolution sociale qui affirme une nouvelle conception de la vie personnelle et une nouvelle idée d’une collectivité composite et mobile, alors s’ouvre un chemin qui mène à une autre façon de raconter, plus proche de la perception d’un réel où une multitude d’événements et de critères d’évaluation se croisent de manière inextricable. Ici la contingence, et non la prédétermination, définit le destin individuel. Cela change substantiellement la forme de projection actorielle du rapport Sujet / Destinateur, le second tendant de plus en plus à se dématérialiser et le premier à prendre de plus en plus en main la formulation de ses propres programmes narratifs. Ici, enfin, on se rend compte que le plan des faits vécus et celui de leur mise en discours ne sont plus tellement séparables. Ce sont là, à coup sûr, différents moments historiques et corrélativement différentes grammaires de la narration. Cependant, ces réflexions ouvrent aussi des questions plus complexes et plus générales, concernant le rapport entre la contingence et la réalité, et les façons dont cette réalité est représentée, lorsqu’elle est traduite en récit, en peinture ou par exemple en drame théâtral. On peut se demander si ce même processus de représentation, en soumettant le réel à un inévitable système de règles, ne conduit pas à superposer aux choses « réelles » une couche sémiotique artificielle, déformante. Est-ce vraiment le monde observé qui constitue l’objet de ces représentations ? ou bien s’agit-il de nous-mêmes, pris sur le fait, représentés en train d’appliquer au monde ces règles normalisantes ? Voilà que la position du narrateur dans le livre de Diderot, ce narrateur placé sur les marges, un pied à l’intérieur et un à l’extérieur de l’histoire énoncée, prend une signification spéciale. Il rappelle en effet le personnage singulier qui, dans le tableau de Degas, Le Comte Lepic et ses filles (considéré par certains critiques comme un exemple clé pour la définition de « ce qui rend moderne l’art moderne »17), se tient sur la marge du tableau, regardant la scène, moitié à l’intérieur moitié à l’extérieur, en même temps observateur et observé. Et cela dans une peinture considérée comme fondamentale en ce qui concerne le concept d’accidentalité et le sens de la contingence qui caractérise au moins une partie de notre sensibilité moderne. |
17 Cf. Kirk Varnedoe, A fine disregard. What Makes Modern Art Modern, New York, Harry N. Abramas, 1990. Pour une discussion sémiotique de ce tableau, cf. G. Ferraro, « Degas e la pittura fotografica : la questione del realismo nella prospettiva della semiotica “neoclassica” », Lexia, 17-18, 2014, ou id., Fondamenti di teoria sociosemiotica, op. cit., pp. 106-108. |
|
Si Degas se présente, pour nos réflexions, comme un auteur clé, c’est en raison du lien explicite qu’il établit entre aspiration au réalisme et éloignement délibéré des règles classiques de la peinture. En ce sens, il est un compagnon idéal de Diderot, qui, à la recherche d’une plus grande « proximité du vrai », rompait avec les règles classiques de la narration. La passion de Degas pour un autre régime de représentation visuelle — celui d’un certain type de photographie — témoigne de son adhésion à un autre type de grammaire, sans confusion avec une recherche de l’irrégularité en tant que telle. Hors des manières dont l’art classique soumet le monde à des méthodes de cadrage et d’équilibrage, il peint des espaces irréguliers et des figurations décentralisées ; hors des façons dont le peintre traditionnel porte sur la toile une réalité prédisposée à cet effet, il arrête des moments aléatoires où une femme sèche ses cheveux ou bâille, où une danseuse touche ses mollets douloureux ou arrange une chaussure. Comme dans les photographies prises à la volée et non posées, il peint des sujets accidentellement couverts par d’autres objets ou coupés en deux, invente des cadrages maladroits en contre-plongée, peint des effets de contre-jour qui gâchent la lisibilité des visages, et ainsi de suite. Il essaie de voir, ainsi, s’il est possible de représenter ce qu’habituellement on ne représente pas, de saisir un monde non préparé, non prédisposé pour sa traduction en image. Mais c’est là plus qu’une méta-réflexion sur les règles d’un genre de peinture, car cela nous amène à poser quelques-unes des questions dernières, et des plus inquiétantes, que la sémiotique peut se poser : de nombreuses formes d’art, narratives, visuelles ou d’autre nature, ne prennent-elles pas la responsabilité de traduire un réel, qui serait autrement dénué d’ordre et de sens, dans une représentation plus ou moins bien arrangée, aplanie, dotée d’un semblant, au moins, de sens ? C’est une question que Samuel Beckett, entre autres, a abordée dans ses romans, en poussant à l’extrême une réflexion sur l’ambiguïté de l’écriture littéraire : instrument de compréhension et d’exploration du monde ? ou pure tromperie, technique spécialisée dans l’invention de règles et de connexions fictives, d’ordres et de rationalités de l’agir qui n’existent pas en dehors de la littérature ? |
|
|
Parmi ses chefs-d’œuvre, le roman intitulé Comment c’est présente, par sa construction, un intérêt particulier pour la théorie de la narration. Sa forme narrative est en apparence très simple : état de départ (le voyage) ? événement (la rencontre) ? état d’arrivée (l’abandon)18. Cependant, cela donne lieu à un récit complexe et labyrinthique qui, moyennant une habile distribution d’indices, de noms et citations de toutes sortes, aménage par avance, pour chaque type de lecteur, la possibilité de l’interprétation de son choix. Le texte permet en effet aussi bien une lecture classiquement philosophique qu’une interprétation épistémologique ou littéraire, sociologique ou religieuse, etc. Si le lecteur n’est pas assez avisé, il risque de retomber dans l’impasse de Sixth Sense : sa petite lampe s’allume (sous la forme de l’une quelconque des isotopies suggérées par le texte), mais elle ne lui sert qu’à confirmer ce qu’il savait déjà. Or, on l’a compris, la littérature est faite au contraire, selon l’auteur du roman, pour étonner, pour conduire le lecteur ailleurs, pour lui faire perdre ses repères. Le héros de Comment c’est est, jusqu’au paroxysme, un homme des règles. Il utilise tous les indices pour saisir l’ordre du monde dans lequel il se trouve, en jauger les habitants, en reconnaître les espaces et les temps, pour préciser la logique des événements, le principe des relations, et par là comprendre parfaitement le passé, saisir le présent, anticiper l’avenir ; la découverte de la Règle l’exalte. Mais la structure narrative est parfaitement à double face, et encore une fois semble suivre le principe selon lequel chacun risque de voir confirmé ce qu’il aime penser : si nous sommes convaincus que de cette manière le protagoniste est en train de se leurrer, nous en aurons la confirmation en voyant l’histoire se terminer par sa déception ; si au contraire nous estimons que le protagoniste a vraiment compris les règles qui régissent son monde, nous en aurons la confirmation en voyant l’histoire se terminer avec la réalisation de ses prédictions. Mais si nous comprenons plutôt que la multiplicité des lectures est inscrite dans le texte, et que s’en rendre compte, c’est en saisir l’indétermination décisive, alors nous approcherons la vraie valeur de ce roman. Les règles régissent-elles l’ordre du monde, ou bien ne font-elles que commander notre pauvre pensée ? Comment est-il possible que ce personnage ait à la fois tort et raison, qu’il comprenne les règles de son monde et que pourtant, en fin de compte, cette compréhension lui échappe ? Si son savoir s’avère en tout cas précaire, la raison est que, tout comme le narrateur de Diderot ou comme l’homme placé à la marge du tableau de Degas, il est à la fois observateur du monde et personnage du monde observé, il est le sujet d’un savoir, mais aussi le sujet de faire et d’être qui est à son tour l’objet de ce savoir. Les deux choses, vivre notre vie de l’intérieur et saisir de l’extérieur les règles qui la régissent, semblent ne pas être compatibles, selon Beckett. De plus, dès les premières lignes, le texte insinue aussi le soupçon que ce qui est exposé à la première personne par le protagoniste n’est pas vraiment sa vie vécue mais seulement une répétition de mots qui émanent de quelqu’un d’autre, d’un narrateur invisible dont le protagoniste ne serait qu’une sorte de rêve. En envisageant la question de ce point de vue, nous devrions peut-être changer notre idée de ce qu’il faut entendre en pensant aux « règles ». On admet en général que les grammaires définissent la forme de notre pensée et par conséquent ce qui établit la forme du monde. Mais si nous devions conclure que ce n’est qu’à travers cette forme que le monde acquiert un sens, alors devrions-nous penser que le sens n’habite le monde d’aucune façon, mais se cache dans le cœur des grammaires, seule véritable référence pour notre soif de sens ? Soit un exemple moins abstrait : l’ordre suprême de l’univers qu’il nous semble pouvoir toucher quand nous écoutons l’une des merveilleuses compositions polyphoniques de Bach, est-il quelque chose auquel cette musique renvoie ? ou bien s’agit-il de quelque chose qui n’existe qu’au sein de ce monde musical, comme un rêve construit et soutenu par ses règles — mieux : par des règles en tant que telles ? |
18 Pour une analyse sémiotique de ce roman, cf. G. Ferraro, Semiotica 3.0, op. cit., pp. 127-133 et 216-224. |
|
Conclusion. Maîtriser les règles Je conclurai ces réflexions en revenant à l’univers musical, et en particulier à Beethoven (comme dans l’article déjà mentionné sur le rythme). Comme cela a été remarqué19, Beethoven a montré qu’il est possible d’atteindre une très haute expressivité et un effet de modernité surprenante en employant des ressources grammaticales (harmonies, progressions, modulations, etc.) typiques de la production musicale de cinquante ans auparavant. Certaines de ses compositions les plus innovantes, et même futuristes, situées au-delà de ce qui pouvait être acceptable à son époque — telle la fugue de la sonate pour piano opus 106, ou celle qui constituait à l’origine le mouvement conclusif du quatuor opus 130 — sont fondées sur un dispositif formel, en l’occurrence celui de la fugue, non seulement repris des temps précédents mais de plus caractérisé par la rigidité géométrique particulièrement accentuée de ses règles de construction ! |
19 Voir par exemple F. Samarotto, « The Divided Tonic in the First Movement of Beethoven’s Op. 132 », in G. Sly (éd.), Keys to Drama. Nine Perspectives on Sonata Form, Farnham, Ashgate, 2009. |
|
Pensons en particulier à cet exceptionnel monument musical que constitue l’opus 120, les 33 Altérations d’une valse de Diabelli20. Rappelons, parce que la référence n’est pas extérieure à la nature de l’œuvre, que cette composition est issue d’un banal concours proposé par Anton Diabelli, connu de Beethoven comme un bon copiste, mais piètre musicien : il s’agissait de composer des variations à partir d’une de ses valses sans aucun intérêt. Beethoven rejeta d’abord la proposition avec dédain, mais ensuite (on voit ici la différence entre rationalité et génie !) il prit en considération les possibilités particulières que pouvaient précisément offrir les contraintes dues à un si pauvre objet musical. Il composa alors une œuvre gigantesque, contenant trente-trois inventions très différentes, ce que William Kinderman a défini comme « le seul chef-d’œuvre qui plonge ses racines dans le lieu commun, dans un thème statique, répétitif et tout à fait banal »21, ou encore une œuvre qui, selon Maynard Solomon, effectue un parcours extraordinaire conduisant « de l’innocence à la connaissance, de la terre au paradis, de l’humain à l’infini »22. L’idée clé de Beethoven est de prendre une si simple composition musicale pour la démonter comme un jouet et en atteindre les éléments premiers, décomposés comme dans une sorte d’autopsie, et ainsi libérés, exaltés, promus à l’absolu de l’art et à des possibilités d’expression illimitées. On pourrait dire que Beethoven montre ici ce qui se passe quand on inverse la direction du parcours génératif, quand on va donc du complexe vers le simple, jusqu’à mettre en évidence les composants et la nature même du langage musical. |
20 Plutôt que Variations, je préfère traduire par Altérations. Beethoven en effet n’a pas utilisé le terme Variationen, pourtant employé par lui dans d’autres cas, mais celui, plus inhabituel, de Veränderungen. 21 W. Kinderman, Beethoven’s Diabelli Variations, Oxford, University Press, 1989, p. 71. 22 M. Solomon, Late Beethoven : Music, Thought, Imagination, Berkeley, University of California Press, 2003, p. 23. |
|
Ici pourrait s’ouvrir un parcours d’étude complémentaire et certainement de grand intérêt. On pourrait effectivement se demander d’où viennent ces éléments premiers, en quel sens il s’agit de composants primaires et élémentaires, et quel est leur statut sémiotique. J’ai présenté quelques indications à ce propos dans l’article déjà cité sur le rythme, en soulignant par exemple le rôle essentiel de l’opposition élémentaire continu / discontinu, opposition catégorielle évidemment fondamentale s’agissant du rythme, mais qu’on retrouve aussi dans les langages visuels comme dans la poésie, dans la gestualité comme dans la syntaxe cinématographique, etc. L’hypothèse que je vais esquisser ici, pour ce qui peut contribuer à une réflexion sur le concept de « grammaire », est la suivante. Au sommet de la pyramide comprenant tous ces systèmes sémiotiques existe un niveau primaire constitué d’une grammaire, puissante mais élémentaire, de nature amodale, en ce sens qu’elle contient des règles et des composantes d’une grande simplicité mais en même temps d’une grande capacité d’expression, qui sont disponibles pour une utilisation dans plusieurs systèmes sémiotiques. En-dessous, mais encore très haut dans la pyramide, se trouvent les bases grammaticales de chaque système expressif — pour prendre un exemple, la base de l’expression picturale, contenant les principes qui valent pour toutes ses formes possibles, ainsi que les options qui conduisent, au niveau suivant, à différencier les grammaires particulières, telles que la grammaire de la peinture impressionniste, cubiste, etc. Encore plus bas, on pourrait situer les différences entre les écoles de peinture plus spécifiques, et si on voulait on pourrait descendre jusqu’au niveau d’un idiolecte entendu à la manière d’Eco comme une sorte de « code personnel ». On obtient ainsi une structure de type vaguement génératif, clairement hiérarchisée. Un tel modèle permettrait de représenter les relations entre des élaborations grammaticales concurrentes (comme dans le cas de deux écoles de peinture différentes), en expliquant leurs différences en termes de choix offerts par un niveau supérieur de fondation grammaticale. Cependant, c’est un fait qu’on utilise communément le terme « grammaire » en se référant à des niveaux de normativité différents (par exemple, on parle aussi bien de « grammaire de la peinture » que de « grammaire de la peinture cubiste »). Il s’agit donc d’une perspective déjà présente, et qu’il conviendrait de clarifier de manière mieux formalisée. A partir de là, on peut comprendre que ce n’est pas un hasard si un artiste, tel Beethoven, auquel nous revenons maintenant, entreprend d’explorer cette pyramide des formes expressives en la remontant vers le haut, en dépassant les différences entre les grammaires musicales de différentes époques et écoles, jusqu’à mettre en lumière les éléments premiers à la racine du langage musical en tant que tel, et même à atteindre ce niveau amodal qui nous a précédemment permis de faire converger un musicien et un peintre — Beethoven et William Turner — dans l’emploi de solutions expressives essentiellement communes23. |
23 “Le rythme comme règle et comme invention”, art. cit., pp. 40-42. |
|
Dans le cas spécifique de l’œuvre dont nous parlions, les 33 Altérations d’une valse de Diabelli, l’originalité de Beethoven ne consiste pas à violer ou à changer les règles et principes de la composition musicale ; au contraire, il annule plutôt l’opposition entre le nouveau et l’acquis, entre le simple et le complexe, entre l’objectivité de la pure matière sonore et la subjectivité de l’émotion. Les moments les plus lyriques naissent souvent des composantes les plus insignifiantes, de leur irréductible matérialité physique, de l’obsession de la répétition imposée par les pauvres symétries de la structure de départ. Il y a quelques variations où Beethoven montre comment il est possible d’utiliser les éléments mêmes de la cage musicale dans laquelle il s’est enfermé pour s’en envoler avec un chant d’une extrême liberté et d’une émotion infinie. Mais dans la plupart des cas, il joue jusqu’au bout sur la contrainte du rythme, sur sa prédétermination et sa prévisibilité, sa presque intolérable mécanicité. Il suffit de noter que la plupart des variations, reprenant la formule sur laquelle se fondait la valse de Diabelli, suivent un schéma dont la régularité devient vraiment obsessive : un schéma divisé en deux parties, la première partie de huit mesures plus huit mesures, répétée et fermée sur l’accord de dominante, la deuxième partie de huit mesures plus huit mesures, répétée et fermée sur l’accord de do majeur. La cage dans laquelle Beethoven a accepté de se faire enfermer semble vraiment être la prison parfaite du musicien créatif ! Mais on voit ici l’attrait paradoxal que peut offrir une régularité à l’état pur— à condition de l’aborder de manière à l’investir de sens. La variation à cet égard la plus emblématique est peut-être la XIVe24. Tous les caractères obsessifs d’une lente, inexorable répétition y sont présents, portés à l’extrême. Pourtant, les interprètes les plus attentifs attribuent précisément à cette variation une charge pathémique spéciale : le pianiste apparaît asservi à ce rythme inexorable qui procède par petites vagues successives comme un mécanisme d’horlogerie, et malgré cela en jaillit une intense émotion ! Pour Beethoven, la recherche de la beauté et de l’intensité de sentiment ne va pas contre les règles ou en dehors de celles-ci : il nous conduit plutôt à pénétrer leur nature la plus intime, au cœur de leurs traits les plus élémentaires. Pourquoi envisager de transgresser les règles quand, si on les entend plutôt comme des ressources, on peut faire beaucoup plus, et même atteindre le maximum de l’innovation, de l’originalité, de la subtilité conceptuelle et de l’intensité émotionnelle ? Il y a là une conception fascinante de la créativité : celle fondée sur la capacité de maîtriser les règles, de ne pas les subir mais de les comprendre et les dominer, d’en accepter la nécessité et par conséquent, aussi, la disponibilité à des emplois toujours différents, souvent imprévus. |
24 On pourra écouter par exemple l’interprétation remarquable de cette variation par Vestard Shimkus, sur Youtube à l’adresse youtu.be/ZOVhyiXKJtg, à la minute 21:18. |
|
Au bout de ces remarques, au moins une réflexion conclusive peut être formulée. Si nous avons vu que raisonner sur les règles de la littérature a fait partie d’une révolution culturelle et sociale, que travailler sur les règles de la musique peut être considéré comme une étape décisive pour la construction de l’artiste « moderne », sujet autonome qui maîtrise les règles et de cette façon forge ses propres règles, que réfléchir sur les règles de la peinture peut conduire à une nouvelle façon de concevoir la représentation même du réel, et ainsi de suite, nous pouvons alors comprendre combien il est important de raisonner sur les règles et les modèles de notre culture, de comprendre leurs possibilités et leurs limites, de savoir comparer différents modèles et déterminer comment ils correspondent à des perspectives alternatives sur le monde. La sémiotique, de son côté, en réfléchissant, comme dans le présent dossier, sur la nature et la valeur culturelle des règles, confirme la pertinence et la centralité de son projet, et donc l’utilité d’un travail qui investit également des questions importantes de politique culturelle. |
|
Bibliografia Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, trad. Paris, Gallimard, 1987. Durkheim, Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse(1912), Paris, P.U.F., 1960. Eco, Umberto, Trattato di semiotica generale, Milan, Bompiani, 1975. Ferraro, Guido, Il linguaggio del mito. Valori simbolici e realtà sociale nelle mitologie primitive, Rome, Meltemi, 2001. — « Antenato totemico e anello di congiunzione. La connessione tra “sacro” e “segno” nel pensiero di Émile Durkheim », in N. Dusi et G. Marrone (éds.), Destini del sacro, Rome, Meltemi, 2008. — Fondamenti di teoria sociosemiotica. La visione “neoclassica”, Rome, Aracne, 2012. — « Degas e la pittura fotografica: la questione del realismo nella prospettiva della semiotica “neoclassica” », Lexia, 17-18, 2014. — Teorie della narrazione, Rome, Carocci, 2015. — Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2019. — « Du début à la fin. Aventures du sens et de l’écriture dans les textes narratifs »,Actes Sémiotiques, 123, 2020. — « Le rythme comme règle et comme invention », Acta Semiotica, II, 3, 2022. Greimas, Algirdas J. et Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979. Gumbrecht, Hans Ulrich, Prose of the World. Denis Diderot and the Periphery of Enlightenment, Stanford, University Press, 2021. Hjelmslev, Louis, Essais linguistiques, Paris, Minuit, 1971. Johnson, Julian, Out of Time. Music and the Making of Modernity, Oxford, University Press, 2015. Kinderman, William, Beethoven’s Diabelli Variations, Oxford, University Press, 1989. Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1965. Samarotto, Frank, « The Divided Tonic in the First Movement of Beethoven’s Op. 132 », in G. Sly (éd.), Keys to Drama. Nine Perspectives on Sonata Form, Farnham, Ashgate, 2009. Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale (1916), Paris, Payot, nouvelle éd. 1967. Solomon, Maynard, Late Beethoven : Music, Thought, Imagination, Berkeley, University of California Press, 2003. Varnedoe, Kirk, A fine disregard. What Makes Modern Art Modern, New York, Harry N. Abramas, 1990. Wall, Anthony, « Bachtin, Diderot, and the simultaneity of meaning », Russian Literature, XXXII, 1992. Whorf, Benjamin L., Language, Thought, and Reality, Cambridge, M.I.T. Press, 1956. |
|
1 On peut rappeler à cet égard l’idée d’Umberto Eco, qui voyait l’invention comme une « institution de code », Trattato di semiotica generale, Milan, Bompiani, 1975, p. 315. 2 Voir en particulier son Trattato di semiotica generale, op. cit. 3 Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979 4 L. Hjelmslev, Essais linguistiques, Paris, Minuit, 1971, chapitre « Langue et parole ». 5 Cf. Cours de linguistique générale (1916), Paris, Payot, nouvelle éd., 1967, pp. 161-162. 6 Language, Thought, and Reality, Cambridge, M.I.T. Press, 1956. 7 Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Paris, P.U.F. 1960, p. 325. Pour une réflexion sur la théorie sémiotique de Durkheim, cf. G. Ferraro, « Antenato totemico e anello di congiunzione. La connessione tra “sacro” e “segno” nel pensiero di Émile Durkheim », in N. Dusi et G. Marrone (éds.), Destini del sacro, Rome, Meltemi, 2008. 8 Morphologie du conte, Paris, Seuil, 1965. 9 Pour cette relecture de la logique constitutive du schéma de Propp, voir G. Ferraro, Teorie della narrazione, Rome, Carocci, 2015. 10 Pour une analyse plus détaillée voir G. Ferraro, Fondamenti di teoria sociosemiotica, Rome, Aracne, 2012, pp. 117-124. 11 Cf. G. Ferraro, « Du début à la fin. Aventures du sens et de l’écriture dans les textes narratifs », Actes Sémiotiques, 123, 2020. 12 Pour une discussion sur la valeur actuelle de la relation topic / focus, cf. G. Ferraro, Semiotica 3.0, Rome, Aracne, 2019, chap.II. 13 Voir G. Ferraro, Il linguaggio del mito, Rome, Meltemi, 2001, pp. 300-305. 14 Cf. H.G. Gumbrecht, Prose of the World. Denis Diderot and the Periphery of Enlightenment, Stanford, University Press, 2021, pp. 69 et 76. 15 Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1987. 16 A. Wall, « Bachtin, Diderot, and the simultaneity of meaning », Russian Literature, XXXII, 1992. L’auteur remarque (p. 4) que le texte de Diderot est plus qu’une version rudimentaire de ce que Bachtin appelle prose polyphonique. 17 Cf. Kirk Varnedoe, A fine disregard. What Makes Modern Art Modern, New York, Harry N. Abramas, 1990. Pour une discussion sémiotique de ce tableau, cf. G. Ferraro, « Degas e la pittura fotografica : la questione del realismo nella prospettiva della semiotica “neoclassica” », Lexia, 17-18, 2014, ou id., Fondamenti di teoria sociosemiotica, op. cit., pp. 106-108. 18 Pour une analyse sémiotique de ce roman, cf. G. Ferraro, Semiotica 3.0, op. cit., pp. 127-133 et 216-224. 19 Voir par exemple F. Samarotto, « The Divided Tonic in the First Movement of Beethoven’s Op. 132 », in G. Sly (éd.), Keys to Drama. Nine Perspectives on Sonata Form, Farnham, Ashgate, 2009. 20 Plutôt que Variations, je préfère traduire par Altérations. Beethoven en effet n’a pas utilisé le terme Variationen, pourtant employé par lui dans d’autres cas, mais celui, plus inhabituel, de Veränderungen. 21 W. Kinderman, Beethoven’s Diabelli Variations, Oxford, University Press, 1989, p. 71. 22 M. Solomon, Late Beethoven : Music, Thought, Imagination, Berkeley, University of California Press, 2003, p. 23. 23 “Le rythme comme règle et comme invention”, art. cit., pp. 40-42. 24 On pourra écouter par exemple l’interprétation remarquable de cette variation par Vestard Shimkus, sur Youtube à l’adresse youtu.be/ZOVhyiXKJtg, à la minute 21:18. |
|
______________ Résumé : On a souvent tendance à penser les systèmes de règles comme des limitations et interdictions qui tombent « du ciel » et nuisent à la libre création. Dans une perspective socio-sémiotique on devrait plutôt les considérer comme le produit d’un travail social : les règles constituent des moyens établis et partagés de réaliser certaines choses. Il ne s’agit donc pas en premier lieu d’un ensemble de limitations et d’interdictions mais plutôt d’un ensemble de ressources. Les systèmes de règles (ou « grammaires ») définissent la forme de notre pensée, et par là, la forme du monde pour nous. Le travail des créateurs est de les transformer, non pas au nom de l’« innovation » pour elle-même, mais pour réaliser des transformations allant dans une direction définie, correspondant à de nouvelles exigences expressives. L’article vise à concrétiser cette perspective à partir d’une série d’exemples tirés de la littérature, de la peinture, du cinéma et de la musique. Resumo : Os sistemas de regras são frequentemente vistos como conjuntos de limitações e de proibições caídas “do céu”, que prejudicam a nossa criatividade. Numa perspetiva sociossemiótica, eles deveriam, antes, ser considerados como o produto de um trabalho social : regras constituem meios estabelecidos e compartilhados para realizar certas coisas. Não se trata em primeiro lugar de limitações ou proibições, mas sim de conjuntos de recursos. Os sistemas de regras (as “gramáticas”) definem a forma de nosso pensamento, e, por aí, a forma do mundo para nós. O empenho dos criadores é de transformá-los, não em nome da “inovação” por si mesma, mas para realizar transformações indo numa direção definida, que corresponde à necessidade de novas formas de expressão. O artigo tenta concretizar essa perspectiva a partir de exemplos emprestados à literatura, à pintura, ao cinema e à música. Abstract : Systems of rules are often seen as limitations and prohibitions falling “from the sky” and hindering our creativity. A sociosemiotic perspective should rather lead to regarding them as the produce of a social elaboration : rules constitute established and shared means permitting specific achievements. In other words, rather than juste limitate or prohibit action they afford resources for doing. Systems of rules (or “grammars”) shape the form of our thinking and thereby the form of the world for us. The task of the “creators” is to transform them, not just for the sake of “innovation” but in order to achieve changes in some definite direction corresponding to the need of new forms of expression. The article aims at concretising this perspective on the basis of examples in literature, painting, cinema and music. Sommario : Si tende spesso a pensare le regole come qualcosa che cala su di noi dall’alto, quasi questo fosse un residuo d’una visione religiosa. Una prospettiva sociosemiotica dovrebbe invece pensare tali sistemi come prodotto di un fare sociale: le “regole” corrispondono a modi condivisi e consolidati di realizzare qualcosa. Non si tratta in primo luogo di limitazioni e interdizioni, ma di risorse. Se le grammatiche si presentano come costruzioni formali, non sono per questo neutre : esse definiscono la forma del nostro pensiero, e di conseguenza quella che ci si presenta come la forma del mondo. Si può, quindi, capire perché sorgano conflitti tra sistemi alternativi e si osservino continue trasformazioni nel flusso del tempo. Il lavoro dei creativi è precisamente quello di trasformare le regole, non tanto nel senso di perseguire una generica “innovazione”, quanto nel senso di trasformare i sistemi di regole in una direzione definita, corrispondente alle nuove esigenze espressive. L’obbiettivo dell’articolo è di rendere concreta tale prospettiva a partire da esempi tratti dalla letteratura, dalla pittura, dal cinema e dalla musica. Mots clefs : code, créativité, grammaire, innovation, narration. Auteurs cités : Mikhaïl Bakhtine, Emile Durkheim, Umberto Eco, Algirdas J. Greimas, Claude Lévi-Strauss, Ferdinand de Saussure, Benjamin Lee Whorf. Plan : 1. « Codes », « langues », et formes d’action sociale 2. Sur le statut des règles de la grammaire narrative 3. Créativité : voir le monde sous une autre lumière 5. Les maîtres des règles et ces messieurs qui se placent sur les marges |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 25/09/2022. / Aceito em 10/10/2022. |