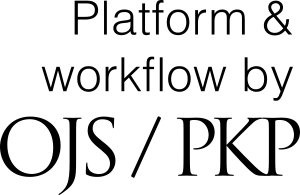De la matière dans l’espace architectura. Comparaison syntaxiquel
DOI :
https://doi.org/10.23925/2763-700X.2024n8.70095Mots-clés :
contrainte, déplacement, espace, force, impénétrable, matière, propagation, syntaxeRésumé
La sémiotique de l’espace a été construite en postulant que l’espace libre, où les hommes construisent pour aménager le cadre de leurs déplacements, n’est pas un simple circonstant de l’action, mais plutôt une étendue découpée en parties discrètes entrant en conjonction et/ou disjonction avec les hommes. La reconnaissance du rôle syntaxique des parties d’espace (ou topoï) entraîne la mise à l’écart provisoire de la composante matérielle de l’architecture. L’analyse fait apparaître la matière comme lieu d’investissement de modalités déterminant l’action. Lorsque la matière est considérée pour elle-même, la perspective constructive s’avère dominante dans un monde soumis à la pesanteur. Certains éléments matériels sont porteurs, d’autres sont portés, alors que d’autres éléments franchissent les espaces libres réservés à l’action. Les propriétés physiques de la matière sont déterminées entre des forces extérieures, capables de la mettre en mouvement ou de la déformer, et des forces intérieures qui équilibrent les charges extérieures. L’état interne de la matière est décrit comme une contrainte. Forces et contraintes se propagent à l’intérieur de la matière pleine, d’une manière qui rappelle le mouvement des hommes dans l’espace libre. Ce parallèle syntaxique est soumis à une analyse comparative.
Références
Abdus Salam, Mohammad, « L’unification des forces », in Paolo Budinich (éd.), L’imaginaire scientifique. De la perception à la théorie à travers les images de la science, Paris, Denoël, 1980.
Bastide, Françoise, « Le traitement de la matière. Opérations élémentaires », Actes Sémiotiques, IX, 89, 1987.
Boyle, Robert, The general history of the air, Londres, Awnsham & John Churchill, 1692.
Bruhat, Georges, Mécanique, Paris, Masson, 1961.
Choisy, Auguste, Histoire de l’architecture, Paris, Gauthier-Villars,1899 (rééd. Paris, Vincent et Fréal, 1954).
Galilée, Galileo, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla Mecanica & i Movimenti locali, Leida, Elsevir, 1638.
Greimas, Algirdas J., et Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Larousse, 1979.
Groupe 107, Sémiotique de l’espace. Architecture, urbanisme, sortir de l’impasse, Paris, Gonthier, 1976.
Hammad, Manar,
a : « Sémiotique de l’espace et sémiotique de l’architecture », in A Semiotic Landscape, Panorama sémiotique, Mouton, La Haye.
b : « Définition syntaxique du Topos », Actes Sémiotiques-Bulletin, 10.
a : « L’espace comme sémiotique syncrétique », Actes Sémiotiques-Documents, VI-27.
b : « L’énonciation, procès et système », Langages, 70.
: « Le Bonhomme d’Ampère », Actes Sémiotiques-Bulletin, VIII, 33.
: « L’architecture du thé », Actes Sémiotiques-Documents, IX, 84-85.
a : « La promesse du verre », Traverses, 46.
b : « La privatisation de l’espace », Nouveaux Actes Sémiotiques, 4-5.
: Le sanctuaire de Bel à Tadmor-Palmyre, Urbino, Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica.
: « Présupposés sémiotiques de la notion de limite », Documenti di lavoro e pre-pubblicazioni, 330, Università di Urbino.
: Lire l’espace, comprendre l’architecture, Paris, Geuthner.
: « Les parcours, entre manifestations non verbales et métalangage sémiotique », Nouveaux Actes Sémiotiques, 111.
: Palmyre, transformations urbaines, Paris, Geuthner.
: « La sémiotisation de l’espace, esquisse d’une manière de faire », Actes Sémiotiques, 116.
a : « Sémiotique de l’espace : faire le point en 2022 », Acta Semiotica, II, 4.
b : « Interpréter la formation des villages néolithiques », Actes Sémiotiques, 126.
a : « De l’espace et des hommes : identité de groupe et traces de la privatisation de l’espace et de la propriété à l’époque néolithique », Acta Semiotica, III, 5.
b : « Des choses et des hommes : les prémices de la propriété des objets », Acta Semiotica, III, 6.
à par. 1 : « Dimensions spatiales et sémantiques ».
à par. 2 : « Entre architecture, sémiotique et physique, y a-t-il place pour la force comme outil descriptif ? »
à par. 3 : « Scellements à Tell Sabi Abyad, une perspective pour l’architecture et les récipients ».
à par. 4 : « Des caches, des hommes et du sens, exploration des manières de faire ».
Hillier, Bill, Space is the machine, Cambridge, Space Syntax, 2001.
Hooke, Robert, De Potentia Restitutiva, Londres, Royal Society, 1678.
Klein, Felix, Le programme d’Erlangen (1872), Paris, Gauthier-Villars, 1974.
Landowski, Eric, « Éléments pour une sémiotique des objets (matérialité, interaction, spatialité) », Actes Sémiotiques, 121, 2018.
Latour, Bruno, Nous n’avons jamais été modernes, essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991.
Leroi-Gourhan, André, L’homme et la matière, Paris, Albin Michel, 1943.
Leroi-Gourhan, André, « L’habitation magdalénienne n°1 de Pincevent près de Montereau (Seine-et-Marne) », in Gallia préhistoire, tome 9, fascicule 2, 1966.
Otto, Frei, Tensile structures, cable structures, Cambridge, MIT Press, 1969.
Poincaré, Henri, Leçons sur la théorie de l’élasticité, Paris, Georges Carré, 1892.
Poincaré, Henri, La valeur de la science, Paris, Flammarion, 1905.
Shapin, Steven et Simon Schaffer, Leviathan and the air pump, Princeton, Princeton University Press, 1985.
Thompson, D’Arcy, On growth and form, Cambridge University Press, 1942. Trad. fr. Forme et croissance, Paris, Seuil, 2009.
Timoshenko, Stephen, Résistance des matériaux (1911), Paris, Dunod, 1968.
Wölfflin, Heinrich, Principles of art history. The problem of the development of style in later art, New York, Dover, 1950.
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.